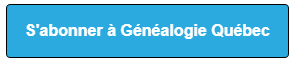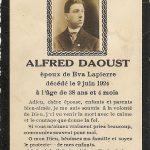Les registres de décès et de sépulture du Québec ont été tenus par l’église puis par le gouvernement depuis maintenant plus de 400 ans. Grâce aux efforts de nombreuses organisations, il est aujourd’hui possible de consulter la majorité de ces documents en ligne. Dans cet article, vous trouverez une liste des meilleures sources de registres de décès du Québec disponibles sur internet.
Pour un article portant sur les avis de décès publiés dans les journaux ou sur internet, rendez-vous à cette adresse.
Le LAFRANCE sur Généalogie Québec (Registres de décès et sépultures du Québec de 1621 à aujourd’hui)

Le LAFRANCE est une collection d’actes paroissiaux contenant plus de 10 millions d’actes provenant des registres de décès, naissance et mariage du Québec, de l’Ontario et de l’Acadie. En plus de millions d’actes de mariage et naissance, on y trouve TOUTES les sépultures catholiques enregistrés par l’église au Québec des débuts de la colonie à 1861, ainsi que des dizaines de milliers de décès datant de 1862 à aujourd’hui.
Rechercher dans le LAFRANCE sur Généalogie Québec ($)
Essayez Généalogie Québec GRATUITEMENT pour 7 jours
Mariages et décès 1926-1997 sur Généalogie Québec
La collection Mariages et Décès 1926-1997 contient la totalité des mariages et décès enregistrés par le gouvernement du Québec durant cette période.
Rechercher dans les Mariages et Décès 1926-1997 sur Généalogie Québec ($)
Essayez Généalogie Québec GRATUITEMENT pour 7 jours
Fichier Connolly et Petit NBMDS sur Généalogie Québec (Registres de décès de 1621 à aujourd’hui)
Le Fichier Connolly et le Petit NBMDS sont des collections contenant des registres de décès, naissance et mariage du Québec. On y trouve entre autre plus de 1 400 000 sépultures du Québec datant des débuts de la colonie à aujourd’hui.
Consulter le Fichier Connolly et le Petit NBMDS sur Généalogie Québec ($)
Essayez Généalogie Québec GRATUITEMENT pour 7 jours
Registres de l’état civil du Québec (1621 aux années 1940)
La collection des registres de l’état civil du Québec est formée des registres paroissiaux produits au Québec entre 1621 et les années 1940. Bien que ces registres soient numérisés, les actes dont ils sont formés ne sont pas indexés individuellement; il faut parcourir le registre manuellement pour y trouver le décès recherché.
Consulter les registres de l’état civil du Québec jusqu’aux années 1940 sur Généalogie Québec ($)
Essayez Généalogie Québec GRATUITEMENT pour 7 jours
Registres des paroisses du Québec (1621 à 1979)
Une seconde copie des registres paroissiaux du Québec était conservée dans les églises elles-mêmes. Celle-ci est aussi disponible en ligne et est accompagnée d’un index partiel. Elle se rend jusqu’en 1979 pour les paroisses catholiques, et 1967 pour les paroisses protestantes.
Consulter les registres des paroisses catholiques du Québec sur Family Search (Gratuit)
Consulter les registres des paroisses protestants du Québec sur Family Search (Gratuit)
PRDH-IGD (Sépultures du Québec de 1621 à 1849)

Le PRDH-IGD contient tous les actes vitaux catholiques du Québec de la fondation de la colonie jusqu’en 1849. En plus de ces actes, le PRDH-IGD contient des fiches servant à reconstituer la vie des individus et des familles ayant vécu au Québec durant cette période. Ces fiches sont interreliées et forment un arbre généalogique exhaustif de la population canadienne-française du Québec jusqu’au milieu du 19e siècle. Avec cet arbre, une lignée généalogique peut être retracée en quelques clics.
Abonnement à PRDH-IGD: à partir de 19,99$
NosOrigines

NosOrigines est une ressource gratuite sur laquelle se trouvent des fiches portant sur des individus et des familles québécoises et acadiennes. La base de ces fiches est souvent l’acte paroissial (baptêmes, mariages et sépultures), et un lien vers le document original auquel fait référence la fiche est parfois inclus.
Consulter NosOrigines (Gratuit)
BMS2000
BMS2000 est un site de recherche offrant plus de 16 millions de registres de décès, naissance et mariage du Québec. La navigation au sein des actes se fait à l’aide d’un engin de recherche, et un lien vers le document original auquel fait référence une fiche est régulièrement inclus.
Abonnement à BMS2000: à partir de 20$
Fichier Origine

Le Fichier Origine est un outil répertoriant les informations vitales disponibles à propos des premiers immigrants des familles du Québec. Chaque pionnier possède sa propre fiche sur laquelle on retrouve notamment les informations de décès, avec référence au registre depuis lequel a été tiré sa sépulture.