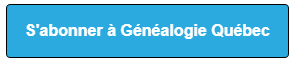(Cet article fait suite à La généalogie et le travail du care)
En tant que généalogistes, nous avons accès à des petites fenêtres sur le passé. Nos histoires familiales, la vie de nos ancêtres, s’inscrivent dans le contexte beaucoup plus large de la société dans laquelle ils et elles ont vécu. Si nous sommes attentif.ve.s dans nos recherches, nous pouvons en percevoir des bribes. Ces petites parcelles de passé peuvent être très instructives et nous aider à mieux comprendre certaines réalités. En ce sens, il me semble que la généalogie peut servir l’émancipation féministe : elle peut éclairer l’histoire des femmes.
En effet, la généalogie peut nous en apprendre beaucoup sur les conditions de vie des femmes à différentes époques. Lors de nos recherches généalogiques, nous sommes amené.e.s à découvrir combien d’enfants ont eu nos ancêtres, à quel intervalle, combien ont survécu, quel âge elles avaient au moment de leur(s) mariage(s) et de leur(s) accouchement(s), si elles ont été veuves, combien de fois, à quel âge, etc. À partir de ces faits, on peut reconstruire leurs histoires de vie, partiellement bien sûr, puisqu’elles ne peuvent se résumer entièrement à leur contexte familial. Toutefois, le rôle des femmes ayant souvent été de s’occuper de la famille, ces faits peuvent nous en apprendre beaucoup sur leurs quotidiens, les grandes étapes de leurs vies et les défis qu’elles ont traversés.


Les fiches d’individu et de famille de Marie Catherine Sicotte, provenant de PRDH-IGD.com nous donnent un aperçu relativement détaillé de la vie de Marie Catherine; son lieu et sa date de naissance, mariage et décès, le nom de ses parents ainsi que la liste de ses enfants incluant le lieu et la date de leur naissance, mariage et décès.
On peut également très certainement voir dans ces informations les différentes façons dont le patriarcat a influencé la vie des femmes. Les normes sociales, parfois subtiles et les lois, beaucoup plus concrètes entourant par exemple les injonctions au mariage et à la maternité, l’accès à la contraception et à l’avortement, se reflètent directement dans nos arbres généalogiques et dans nos histoires de famille. Lorsque nous connectons les histoires de vie de plusieurs générations, nous pouvons même constater comment ces influences ont évolué à travers les décennies, voire les siècles.
La généalogie peut aussi permettre de comprendre quel rôle les femmes jouaient au sein de la société. Si les documents dont nous nous servons dans une recherche généalogique mentionnent souvent le métier des hommes, c’est beaucoup plus rarement le cas pour les femmes, qui s’occupaient généralement de la famille ou qui aidaient, dans l’ombre, leur mari avec l’entreprise familiale. Toutefois, il existe une exception : le travail de sage-femme! Les sages-femmes qui ont aidé un enfant à naître sont ainsi parfois mentionnées sur les actes de baptême.

Source:Acte 2953156, LAFRANCE, GenealogieQuebec.com
Les rôles que les femmes jouaient au sein de nos sociétés sont rarement valorisés. Ils étaient pourtant d’une importance capitale! Les sages-femmes pouvaient être des ressources médicales de proximité indispensables, surtout dans des villages plus petits ou éloignés où l’accès à un médecin n’était pas toujours garanti (Laforce, 1983 :7 ; Bates et al, 2005 :18). Le travail ménager et l’éducation des enfants sont également essentiels dans n’importe quelle famille, et c’est souvent parce que les femmes s’en occupaient que les hommes étaient en mesure de se consacrer à d’autres activités, plus publiques et davantage vues comme importantes (comme la politique, l’art, la science, etc).
Cette dévalorisation se poursuit encore aujourd’hui : il n’est pas rare que les femmes qui choisissent de rester à la maison sont considérées comme ne travaillant pas (comme le soulignait déjà la pièce de théâtre « Môman travaille pas, a trop d’ouvrage » (Théâtre des cuisines, 1976)), et les emplois traditionnellement féminins sont significativement sous-payés. Comme le souligne la Fondation canadienne des femmes : « les classes professionnelles à majorité féminine sont généralement perçues comme non qualifiées, car les tâches en question sont généralement associées au travail domestique dont les femmes se chargent gratuitement au foyer » (Fondation canadienne des femmes, 2021). En mettant ces rôles de l’avant dans nos recherches généalogiques, nous pouvons participer à les revaloriser, afin que les contributions des femmes du passé et du présent soient davantage reconnues.
Ce genre de recherches généalogiques permet aussi de faire le pont entre les histoires familiales, personnelles à chaque chercheur.euse et l’histoire beaucoup plus globale d’une société. La généalogie participe ainsi à lier les sphères publique et privée, que le modèle patriarcal nous présente comme fondamentalement opposées (Bereni et Revillard, 2009). Cette opposition est directement liée à l’oppression des femmes : c’est parce qu’il s’agit de domaines complètement différents, voire incompatibles que l’assignement des femmes à la sphère privée les exclut de facto de la sphère publique.
Les féministes se sont donc attelées à déconstruire cette opposition : c’est notamment cette idée qui est portée par le célèbre slogan des féministes radicales « le privé est politique ». On pourrait ainsi considérer que certaines pratiques généalogiques, en liant les deux sphères et en brouillant la frontière qui les sépare, participent à cette déconstruction et au projet d’émancipation féministe !
Audrey Pepin
Bibliographie :
Bates, Christina, Dodd, Diane et Rousseau, Nicole (2005). Sans Frontières : quatre siècles de soins infirmiers canadiens. Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa. 248 p.
Bereni, Laure et Revillard Anne. (2009). « La dichotomie “Public-Privé’’ à l’épreuve des critiques féministes: de la théorie à l’action publique ». Dans Genre et action publique : la frontière public-privé en questions, Muller, P. et Sénac-Slawinski, R (dir.). Paris : L’Harmattan. p. 27-55.
Fondation canadienne des femmes (2021). L’écart salarial entre hommes et femmes au Canada : les faits [En-Ligne]. Récupéré de : https://canadianwomen.org/fr/les-faits/lecart-salarial/
Laforce, Hélène (1983). L’évolution du rôle de la sage-femme dans la région de Québec de 1620 à 1840. (Mémoire de maîtrise). Québec : Université Laval, 368 p. Récupéré de : https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/28994
Théâtre des cuisines. (1976). Môman travaille pas, a trop d’ouvrage. Montréal : Les Éditions du Remue-Ménage, 78 p.